Il est important de comprendre ce qu'est le datacenter. Il s'agit d'une infrastructure dédiée au traitement et au stockage des données. Elle peut être physique ou cloud. C'est l'entreprise qui reste au contrôle des centres de données sur site. Ces derniers s'appuient sur des serveurs hébergés en interne. Quant aux datacenters cloud, ils reposent sur des équipements distants. Vous pouvez les louer à des fournisseurs professionnels pour profiter de leur flexibilité et de leur évolutivité. Non seulement le cloud permet aux entreprises d'améliorer la sécurité et la gestion des data, mais il vise surtout à réduire significativement les coûts. La colocation combine ces deux solutions en hébergeant les serveurs dans un centre tiers, avec une maîtrise optimale à la clé. Le point dans ces quelques lignes.
Qu'est-ce qu'un centre de données sur site ?
Un centre de données sur site est une infrastructure informatique qui est gérée directement dans les locaux d'une entreprise. Cette dernière peut alors assurer le contrôle total de ses systèmes de stockage, ses serveurs et ses équipements réseau. Elle peut aussi garder un œil sur ses dispositifs de sécurité. Les entreprises investissent dans ces modèles pour se conformer à des exigences strictes en termes de conformité. Elles y ont également recours pour protéger leurs données sensibles.
La mise en place de ces centres sur site requiert un budget assez conséquent. Cela s'explique par la nécessité de créer un espace dédié et des dispositifs d'alimentation, de refroidissement et de sauvegarde. À part cela, une équipe informatique est aussi de mise pour la maintenance régulière du matériel. Elle intervient aussi pour la surveillance des serveurs et leur protection physique. Cette dernière inclut les badges d'accès, la vidéosurveillance, et la biométrie, limitant ainsi l'accès aux infrastructures.
Malgré cet investissement initial élevé, ils proposent une personnalisation complète des protocoles de protection. Ces centres sur site restent incontournables pour les entreprises qui veulent éviter les risques liés au cloud et à la colocation. Seuls les employés autorisés peuvent y accéder, et la firme définit elle-même ses propres politiques d'accès. Ces datacenters demeurent des piliers pour gérer efficacement les services internes tout en conservant la confidentialité des données.
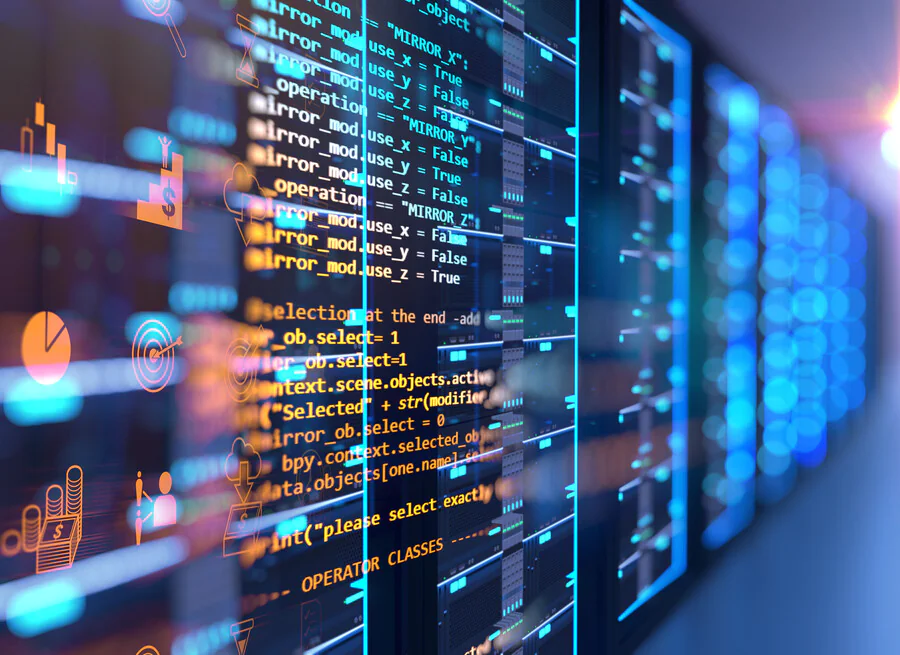
Qu'est-ce qu'un centre de données cloud ?
Le cloud data center s'appuie sur des infrastructures distantes. Elles sont accessibles via Internet. Leur capacité à héberger des serveurs, des services virtuels et du stockage font partie de leur particularité. L'un des principaux avantages de cette solution est sa scalabilité. Les organisations peuvent adapter leurs ressources en fonction de la demande, sans acheter de nouveaux matériels informatiques. Elle est également prisée pour sa souplesse rare. Le cloud vise à faciliter l'intégration avec d'autres services numériques. Les outils analytiques et les applications collaboratives en font partie.
Contrairement aux centres de données sur site, le cloud permet aux entreprises de déléguer la gestion de l'équipement et sa maintenance à un fournisseur qualifié. Ainsi, elles ne font pas face aux contraintes techniques. Toutefois, il faut savoir que la dépendance à une tierce personne peut représenter un risque, notamment en matière de souveraineté des données. Le cloud hybride et la colocation s'imposent dans ce cas précis. Ce sont des compromis efficaces entre contrôle et sécurité.
Les données sensibles pourront être préservées grâce à des datacenters cloud dotés de protocoles avancés. L'idéal serait qu'ils intègrent également des multiples redondances. On peut donc avancer que ces modèles sont indissociables des entreprises cherchant évolutivité, agilité et réduction des coûts dans leur infrastructure informatique.
Qu'en est-il du fonctionnement du modèle de responsabilité partagée ?
Le modèle de responsabilité partagée définit distinctement les obligations entre le fournisseur cloud et l'entreprise utilisatrice. Selon ce modèle, la gestion et la sécurité de l'infrastructure physique ainsi que les serveurs incombent au prestataire. L'organisation, quant à elle, est responsable de la sécurité des données et de leur contrôle. Cette division permet de clarifier les rôles afin d'éviter les malentendus et les failles. L'environnement est sécurisé par le cloud, mais l'usager se doit de gérer efficacement ses données et ses accès.
En appliquant ce modèle, les entreprises sont confrontées à des risques internes si elles négligent leurs responsabilités. Un manque de contrôle ou des erreurs de configuration peuvent compromettre la protection des informations. Le fournisseur se charge de la maintenance physique et réseau, tandis que l'organisation gère son contenu et ses usagers. D'une part, la responsabilité partagée permet de se protéger d'éventuelles intrusions. De l'autre, elle renforce la conformité aux normes réglementaires.
Il est bon de noter que la réussite de ce partage se base sur une collaboration transparente entre les deux entités. Chacun assume son rôle sans empiéter sur celui de l'autre. Si cela est respecté, la confiance règne.

Centre de données sur site ou cloud : lequel choisir ?
Le modèle choisi par l'entreprise sera en fonction de ses besoins spécifiques. De nombreux facteurs stratégiques peuvent aider à mieux affiner son choix. Pour un datacenter sur site, il faut un investissement initial élevé. Il servira à acheter le matériel et à assurer la maintenance ainsi que la sécurité physique. Cette solution, idéale pour les entreprises avec des exigences réglementaires strictes, permet de contrôler les données sensibles. C'est aussi le cas pour les serveurs.
Le cloud est indissociable des organisations numériques. Pour sa part, il se repose sur les dispositifs de sécurité du fournisseur. Quant à sa tarification, celle-ci est plus flexible. Elle réduit considérablement les coûts fixes via la location d'équipements virtuels. Ce modèle délègue la maintenance au prestataire, alors qu'une équipe interne doit intervenir sur site. Comparé à ce dernier, il peut rapidement s'adapter aux fluctuations de la demande. Il est bon de rappeler que le cloud requiert un partage des responsabilités en matière de sécurité. Cela impose une gestion rigoureuse émanant de l'organisation.
Chaque modèle dispose de ses avantages et inconvénients respectifs. Ils sont le plus souvent relatifs à la sécurité, au coût et à la flexibilité. Dans tous les cas, votre choix se fera en fonction de vos objectifs et de votre budget. Vous devez également vous attarder sur le niveau d'expertise informatique.
Quels sont les principaux critères de comparaison ?
Le choix entre le centre de données sur site et le cloud doit considérer plusieurs critères essentiels afin de guider la décision. Cette analyse permet d'anticiper les impacts sur les infrastructures des entreprises. Elle est aussi prise en compte dans l'élaboration de leur budget et l'évaluation de leur performance opérationnelle.
- Les coûts : qui dit centre interne dit investissements initiaux élevés (énergie, matériel et frais de maintenance). Les coûts du cloud, eux, sont proportionnels à l'usage. Cette évolution du tarif est bénéfique pour la gestion financière. Elle peut cependant générer des dépassements imprévus si la consommation s'envole.
- La sécurité : une protection physique complète vient avec le datacenter interne, tandis que sur le cloud, elle est partagée avec le prestataire. Même si ce dernier fournit des couches multiples, l'entreprise doit faire preuve de vigilance accrue.
- L'accessibilité des données : les centres internes proposent un contrôle immédiat. Le cloud, en revanche, ne peut pas fonctionner sans une bonne connexion internet.
- L'évolutivité : la flexibilité fait partie des atouts du cloud. Les ressources nécessaires s'adaptent en fonction des besoins, ce qui permet de réduire les délais. Quant au centre interne, il a besoin d'investissements matériels pour accroître leur capacité.
Une fois que ces critères sont analysés correctement, il est facile pour l'entreprise de choisir en toute connaissance de cause.
Pourquoi opter pour un fournisseur de confiance est essentiel ?
Vous devez vous fier à la sécurité des données pour choisir une solution cloud ou datacenter. La fiabilité d'un fournisseur se mesure à sa capacité de protéger efficacement les données. Son intervention se fait sur le plan numérique et physique. Grâce à lui, elles ne risquent pas de se perdre ou d'être attaquées. Il est alors conseillé de s'associer à des fournisseurs titulaires de certifications validées. D'une part, elles attestent de leur expérience. De l'autre, elles sont un gage de leur conformité aux normes internationales.
En second, il est important d'opter pour un prestataire qui peut fournir un support rapide et personnalisé. Ainsi, il est habilité à garantir une migration facile et fluide. Son accompagnement professionnel facilite également la maintenance avec zéro erreur technique. Vous pouvez évaluer l'expertise locale pour trouver votre perle rare. En outre, un fournisseur à proximité est le garant d'une meilleure compréhension des contraintes réglementaires et métiers propres à chaque organisation.
Être en relation avec un expert confirmé vise à optimiser la continuité des services. Cette collaboration permet également de réduire les incidents liés aux données. Elle structure la sécurité de l'infrastructure et la confidentialité des informations sensibles. Les entreprises peuvent alors être sereines, car leur gestion interne est fiablement structurée et encadrée. Elles peuvent alors profiter pleinement des avantages des datacenters et des solutions cloud.

Questions fréquentes sur les centres de données et le cloud
Les centres internes sont-ils plus compétents que le cloud ? Quel modèle est le plus fiable au niveau de la sécurité ? Ces questions reviennent sur le devant de la scène quand on se réfère à ce sujet. Découvrez nos réponses dans cette FAQ.
Quels sont les enjeux environnementaux ?
Les centres sur site sont gourmands en énergie, notamment pour refroidir les serveurs. Le cloud maximise généralement cette consommation par mutualisation. Quoi qu'il en soit, l'enjeu carbone reste un défi majeur pour ces deux solutions. Les entreprises doivent donc se diriger vers l'usage d'énergies renouvelables pour limiter cet impact.
Comment le coût du cloud est-il calculé ?
Le prix prend en compte l'usage en stockage, en ressources et en bande passante. Les services supplémentaires aussi entrent en cause. La facture se base sur un modèle à la demande dont les tarifs sont dégressifs. Grâce à cet aspect, les entreprises peuvent gérer au mieux leurs dépenses. Toutefois, elles doivent rester attentives pour éviter les dépassements.
Quelles différences entre cloud public, privé et hybride ?
Les ressources sont partagées entre plusieurs clients pour le cas d'un cloud public. Cela garantit une économie d'échelle. La version privée est dédiée à une organisation exclusive pour un contrôle accru. Le cloud hybride associe les deux modèles. Il permet de bénéficier de la flexibilité du premier et de la sécurité du second.
Le cloud data center, vers une infrastructure hybride et optimisée
Comme on l'a vu précédemment, le choix entre ces deux modèles est conditionné par les besoins de l'entreprise. Si le cloud offre une belle flexibilité et une évolutivité optimale, la sécurité et le contrôle strict restent les atouts phares du datacenter sur site. La tendance d'aujourd'hui se penche plutôt vers les infrastructures hybrides, car elle donne accès à la souplesse et à la maîtrise en même temps. Cette approche efface les limites de chaque modèle en optimisant les coûts, l'évolutivité et la sécurité. La réussite s'obtient par une stratégie personnalisée. Elle répond aux exigences des métiers numériques et s'aligne à la performance IT. Cette méthode est indispensable pour évoluer dans un monde numérique en constante transformation. Les entreprises et les fournisseurs certifiés qui agissent de connivence garantissent l'optimisation des environnements virtuels et physiques.
